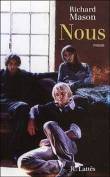Richard Mason : « J’ai retrouvé le plaisir de raconter des histoires… »
Rencontre
pillow-books a aimé 17, Kingsley Gardens, le troisième roman du sud-africain Richard Mason (voir chronique du 10 mai dernier). A 31 ans, ce jeune phénomène vit de sa plume depuis le succès planétaire de son premier roman Le bal des imposteurs (Drawning people). Rencontre dans la paisible véranda de l’hôtel Les marroniers, à Saint-Germain, sur le thème de la fabrique d’un roman.
 « Je crois que j’ai retrouvé le plaisir de raconter des histoires… »
« Je crois que j’ai retrouvé le plaisir de raconter des histoires… »
pillow-books : comment vit-on le succès à l’âge de 21 ans ?
Richard Mason : Mon roman avait été publié dans 20 pays. J’ai vécu une grave crise. Je n’avais plus la force d’écrire, ni de vivre. Je pensais à l’époque qu’il était possible de continuer à écrire et d’assurer la promotion d’un livre. Le fait d’écrire ne me procurait plus de plaisir. Or, le désir de raconter des histoires était essentiel pour moi. J’étais perdu. Dix ans plus tard, j’ai établi une règle : je n’écris plus quand je fais de la promotion. J’écris à ma façon. Je ne reçois plus d’avance et je ne parle plus avec mon éditeur. Ecrire est un voyage intérieur. Avec 17, Kingsley Gardens, j’ai voulu retrouver la joie de raconter les histoires que j’avais quand j’étais enfant et adolescent. Je me suis amusé en l’écrivant. Je crois que j’ai retrouvé le plaisir de raconter des histoires…
Qu’écriviez-vous à l’époque ?
J’ai essayé d’écrire mon premier roman à l’âge de 8 ans. J’ai toujours rêvé d’être écrivain. J’ai écrit mon premier roman à l’âge de 16 ans. J’avais 21 ans quand il a été publié, juste avant de rentrer à Oxford pour étudier la littérature anglaise.
« Je n’ai pas de passeport britannique, seulement sud-africain »
Comment avez-vous eu l’idée de votre premier roman ?
J’étais tombé amoureux d’une jeune fille. Je suis né en Afrique du Sud, où mes parents étaient très engagés contre l’Apartheid dans les années 80. Nous avons émigré en Grande-Bretagne quand j’avais 10 ans. Je n’ai pas de passeport britannique, seulement sud-africain. En arrivant, j’ai découvert un monde bizarre, plein de rituels et de règles non écrites. C’était fascinant. Dans Le bal des imposteurs, j’ai voulu décrire la situation d’une jeune fille confrontée à ce monde qui a certainement existé, mais qui existe de manière de plus en plus dissimulée. Le monde des châteaux et des rallys fait plutôt low profile (profil bas) aujourd’hui.
Science, finance, vieillesse, folie, la musique, l’histoire politique : vous développez de nombreux thèmes dans 17, Kingsley Garden. Une matière aussi dense, c’est rare…
Mes éditeurs ont eu du mal à résumer le livre sur la quatrième de couverture. La véracité est essentielle à mes yeux si l’on veut créer un monde en trois dimensions. Je voulais créer des personnages en relief, avec des passions et des expériences différentes. Le résultat, c’est un livre avec beaucoup de thèmes.
Vous vous êtes inspiré de votre histoire familiale dans ce nouveau roman ?
NedeK, ma grand-mère Afrikaans, a inspiré celle de Joan. Pendant la guerre Anglo-Boers entre 1899 et 1902, alors qu’elle était une enfant, elle avait perdu sa mère et sa sœur préférée dans un camp de concentration bâti par les Anglais. Lorsque sa fille préférée, ma mère, a eu l’audace de se marier avec un Anglais pure souche, elle a donc failli avoir une attaque. Je n’ai jamais connu NedeK. Tout ce qu’il me reste d’elle, ce sont des photos qui ont pâli avec le temps. Les conséquences politiques de cette époque ont été totalement oubliées. Il est de la responsabilité d’un auteur de faire revivre les histoires du temps passé. Il était très important pour moi de retracer mon histoire personnelle.
« Perdre la boule ? C’est très amusant ! »
Vous êtes-vous rendu sur place, comme le personnage de Joan ?
J’ai fait une sorte de pèlerinage à Bloemfontein en Afrique du Sud en 2004. Il est très important pour moi de m’impliquer dans la vie pour écrire. De ne pas rester dans un bureau. La réalité est toujours plus bizarre et compliquée qu’on ne l’imagine. La scène où Joan et Eloïse découvrent le journal intime de leur ancêtre au musée, c’est exactement comme cela que les choses se sont passées pour moi. J’ai enquêté dans des hedge funds pour le personnage d’Eloïse (trader en matière premières, NDLR) et dans des maisons de retraites en Afrique du Sud. J’y ai rencontré une veille dame, Eillen, belle, chic, avec un air raffiné. J’ai décidé de lui faire confiance et je lui ai raconté l’histoire de mon livre. A la fin d’un déjeuner, j’ai pris mon courage à deux mains et je lui ai posé la question. Elle m’a pris la main et elle m’a dit « Oui, perdre la boule, c’est très amusant ! ». J’ai réellement assisté à un cours d’aérobic pour personnes âgées : c’est hilarant de voir une vieille faire de l’aérobic
dans une chaise roulante !
Pour vos deux premiers romans vous aviez aussi réalisé ce travail d’enquête ?
Non, pas tellement. J’étais si jeune… Je vivais à Prague quand j’ai écris mon premier roman et une partie de ce livre se passait à Prague. Une grande partie se passait aussi à Oxford.
La manière dont le passé pénètre le présent est intéressante dans ce roman…
J’ai travaillé pendant deux ans avec l’idée d’écrire un roman qui se passait au XIXème siècle sur la famille Huntley (des militaires responsables d’exactions contre les Boers, NDLR). J’avais imaginé leur maison à Londres. Puis une vieille dame est venue toquer à ma porte. C’était le personnage de Joan. Je me suis dis : « Ce personnage me demande de le suivre. OK, je vous suivrai ! ».
En France on évoque souvent l’art du story telling (art de raconter les histoires) britannique. Est-ce une spécificité ?
Chaque langue a ses qualités propres. Beaucoup de philosophie est écrite en allemand car c’est une langue très logique. En anglais, il existe beaucoup d’adjectifs qui offrent de nombreuses manières de décrire les choses. C’est une bonne langue pour dire précisément ce que l’on veut.
Certains auteurs vous ont-ils inspiré ?
J’aime Kazuo Ishiguro et Allan Hollineghurst, notamment son dernier roman, La ligne de beauté.
« Les livres du début du XXème étaient courts. Ils disaient tout un monde, tellement vivant, vif et plein de vérité »
La période fin de siècle, évoquée dans 17, Kingsley Garden, vous est-elle particulièrement chère ?
Le monde moderne a commencé autour de 1860. C’est la grande époque où l’on a créé la lumière électrique, les voyages à grande vitesse, les supermarchés et les petites annonces amoureuses, la publicité… J’aime beaucoup l’écriture des années 30-40. D’Evelyn Waugh ou E.M. Foster. Fiztgerald. Aujourd’hui, on écrit des livres beaucoup trop longs parce qu’on écrit avec un ordinateur. Les livres de cette époque étaient courts. Ils disaient tout un monde, tellement vivant, vif et plein de vérité.
Que pensez-vous des cours de creative writing (atelier d’écriture)?
Je suis moi-même professeur de creative writing. Je crois que si quelqu’un n’a pas d’oreille pour la langue, il n’est pas possible de le lui enseigner. Mais si on peut distinguer une belle phrase d’une autre phrase, s’il y a une humanité, il est probablement possible de raffiner, de progresser dans le cadre d’un atelier d’écriture.
R.M. : Que pensez-vous du personnage d’Eloïse ? Les réactions des lectrices sont très contrastées à son égard…
p.-b. : De la compassion. Elle a beaucoup d’obligations, et on lui fait de mauvais procès parce qu’elle n’a pas d’enfants et travaille beaucoup…
R.M. : Eloïse est confrontée à un dilemme que nous connaîtrons tous un jour : que faire avec nos parents âgés ? Est-il nécessaire de les avoir chez nous ? Est-ce un cauchemar ? Un rêve ? Moi, j’adore mes parents mais je ne suis pas certain de vouloir vivre à nouveau avec eux…
Ce livre est le plus autobiographique de ceux que vous avez écrits ?
J’ai effectivement repris l’épisode d’un concours de piano, que j’ai vécu à 15 ans. Et ce n’est pas mon habitude. Il est rare pour moi de reprendre une scène de la vie réelle et de l’intégrer dans un livre. Mais chaque livre est autobiographique et ne l’est pas.
R.M. : Connaissiez-vous les nocturnes de Chopin avant de lire le roman ?
p.-b. : Non.
R.M. : Quel effet cela faisait-il de le lire sans connaître Chopin ?
p.-b. : Ca m’a donné envie de les entendre.
« Je découvre des histoires dans des morceaux de musique »
R.M. : Ca n’était pas difficile à comprendre sans avoir l’expérience de la musique ? Je voudrais publier mes romans suivants avec un CD. Si on peut écouter la musique, le livre devient tridimensionnel. Il est difficile de décrire la musique. L’art de l’écrivain nécessite de développer la perspective pour révéler les histoires qui nous entourent. Car il y a plein d’histoires partout : de temps en temps, je trouve des histoires dans un morceau de musique. La phrase de Méphisto de Liszt. Quand j’ai décidé que la folie de Joan concernait sa famille et non les Huntley. J’ai décidé que toute l’histoire de son mariage était là ! Dans ce morceau, on entend la répétition du travail ménager, la présence d’un mari rempli de rage mais aussi soudainement le thème expresivo amoroso. J’ai découvert : « Oui, elle a eu un amour ! ». Le thème dans la musique m’en a donné l’idée. Dans mon nouveau roman, la musique de Carmen joue un rôle important.
Le thème de votre prochain roman ?
La vie plaisir…
17 Kinsgley gardens de Richard Mason
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Sylvie Schneiter
JC Lattès, 472 pages, 22 euros